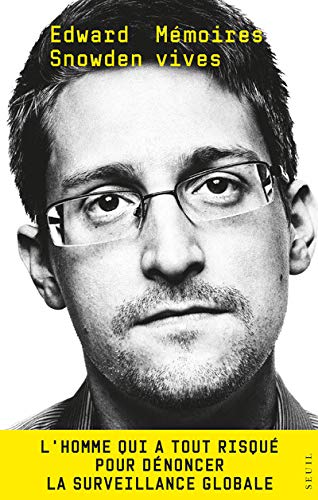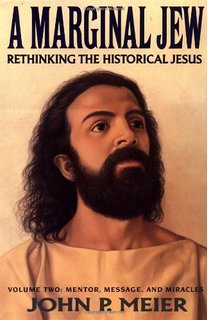François Héran est un sociologue, anthropologue et démographe, spécialiste des migrations. Ancien directeur de l’INED, passé également par l’INSEE, il est depuis 2017 professeur au Collège de France et titulaire de la chaire “Migrations et sociétés”. Lire la suite
Note de lecture
Note de lecture : Les croisades vues par les Arabes, par Amin Maalouf

C’est l’un des premiers ouvrages d’Amin Maalouf (1983), et pourtant l’un des rares que je n’avais pas encore lu. J’avais chroniqué ici quelques-uns de ses romans (voir ici). Le livre est excellent, même s’il ne faut pas s’attendre à un ouvrage de référence sur la question des croisades. Maalouf est un écrivain, lettré, érudit et excellent connaisseur du monde arabe, avec lequel il est généralement sévère (lire absolument Le Dérèglement du Monde, publié en 2009), mais pas un historien professionnel. Surtout, comme le titre l’indique, le parti pris est de s’appuyer exclusivement sur des sources arabes, c’est-à-dire des chroniqueurs de la période des croisades qui s’étend de 1096 à 1291. On peut donc certainement reprocher au livre un manque de rigueur scientifique, mais ce n’est pas vraiment l’ambition de Maalouf, qui cherche plutôt à livrer, comme à son habitude, un récit agréable à lire, à la fois historique et sourcé mais aussi souvent romancé, et qui se lit comme un essai.
Note de lecture : Manières d’être vivant, par Baptiste Morizot

Quid ?
Baptiste Morizot est un philosophe (Université d’Aix-Marseille) dont on pourrait dire que la spécialité est l’écologie, plus précisément les relations entre les êtres humains et les autres êtres vivants. Manières d’être vivant est un livre percutant et assez original, puisqu’il alterne réflexions philosophiques dans un vocabulaire pointu et récits de pistages, Morizot étant avec sa compagne une sorte d’amateur passionné du pistage d’animaux sauvages, en particulier des loups (et des relations entre loups, brebis et bergers). Le livre est donc à la fois très conceptuel (la philosophie) et très concret (les récits de pistages), le concret l’emportant souvent sur le conceptuel car chez Morizot le concept n’a de valeur qu’ancré dans le terrain.
Le livre parle donc d’écologie, bien sûr, mais avec un point de vue tout à fait différent de ce qu’on a l’habitude d’entendre sur le sujet, où foisonnent surtout des livres scientifiques (l’état de l’art à base de données chiffrées) ou politiques (ce qu’il faudrait faire selon moi).
La thèse du livre
Elle peut se résumer simplement : la crise écologique est avant tout une “crise de la sensibilité”, c’est-à-dire un appauvrissement considérable de nos relations avec le vivant, soit tous les autres êtres vivants non humains. Cet appauvrissement se manifeste concrètement : on peut par exemple faire référence aux classiques sondages chez les petits sapiens (du moins pratiquement tous ceux qui vivent dans un système à économie de marché), qui sont capables de citer et reconnaitre des centaines de marques commerciales de multinationales, de différencier finement Coca de Pepsi, la Switch de la PS4 et la PS4 de la PS5, mais ne savent pas nommer les plantes de leur jardin, distinguer une feuille de chêne d’une feuille d’érable, reconnaitre le moindre chant d’oiseau et plus globalement ignorent complètement l’existence d’un monde vivant autour d’eux. Que dire des adultes (moi le premier) ! L’appauvrissement se manifeste donc concrètement par un recul considérable des relations (un concept clef chez Morizot) des êtres humains avec les êtres non-humains.
Contre le dualisme Nature/Culture
Selon Morizot, cet appauvrissement prend sa source dans le dualisme Nature vs Culture, à la fois très occidental et très récent à l’échelle de l’histoire humaine. D’un côté, la “Nature”, cet ensemble vivant d’animaux et de végétaux que l’homme civilisé se doit de dominer, exploiter, asservir pour ses besoins propres : se nourrir, se vêtir, se divertir. De l’autre la culture, le propre de l’homme civilisé. Celui-ci se doit, intérieurement, de lutter contre ses pulsions bestiales, c’est-à-dire de dompter l’être sauvage qui vit en lui par les forces de la loi, de la morale, de l’éducation, de la religion ; et extérieurement, de dominer la Nature pour construire la société humaine civilisée.
Ce dualisme s’accompagne d’une hiérarchie morale qui place l’homme au sommet, la Culture étant supérieure à la Nature. Dans la philosophie classique, les animaux n’ont de liberté propre : chez Aristote, ils sont dépourvus de raison ; pour Descartes, ce ne sont que des machines, dépourvues de sensibilité, d’âme et de raison, qui réagissent automatiquement à des stimulis. Rousseau est un peu plus subtil mais guère différent dans le fond : les animaux ont une forme simple de raison et de sensibilité mais n’ont pas de perfectibilité morale : ils n’ont que des instincts qui les conditionnent tout entier. Citons ainsi le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes :
La nature fait tout dans les opérations de la bête (…) ce qui fait que la bête ne peut s’écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il serait avantageux de le faire.
Plus récemment, des philosophes comme Sartre ou Camus sont, selon Morizot, des “alliés objectifs de l’extractivisme et de la crise écologique”, car “ce sont eux qui ont transformé en croyance fondatrice de l’humanisme tardif le mythe suivant lequel nous étions les seuls sujets, libres, dans un monde d’objets inertes et absurdes”.
Ainsi, il faudrait en finir avec ce dualisme :
[Les autres animaux] n’incarnent pas une sauvagerie débridée (c’est un mythe de domesticateur), pas plus qu’une innocence plus pure (c’est son envers réactif). Ils ne sont pas supérieurs à l’humain en authenticité ou inférieurs en élévation : ils incarnent avant tout d’autres manières d’être vivant.
Les philosophes classiques mettent l’homme au dessus de tout par ses prodigieuses capacités cérébrales, la complexité de son langage, de sa morale ou de sa vie en société. Morizot ne nie nullement cela mais rappelle que toute espèce, en un instant N, est accomplie d’un point de vue évolutionnaire. Si l’on valorise la complexité du langage, l’art ou la vie en société, l’être humain est supérieur, mais si l’on valorisait la rapidité à la course, la force musculaire, l’agilité dans l’eau, l’écholocalisation, l’ouïe, la vue et l’odorat, ou encore la capacité à se nourrir du carbone de l’air à partir du soleil, l’être humain serait tout en bas dans les hiérarchies morales, et nous serions supplantés par les poissons, les chauves-souris, les plantes, les rapaces, les chats, les chimpanzés. Ce n’est pas très original de rappeler qu’homo sapiens ne se caractérise pas par ses capacités physiques et sensorielles extraordinaires.
Quant à la notion d’intelligence, que le philosophe définit comme “la capacité à résoudre des problèmes complexes sans posséder les patrons moteurs a priori, au sens de suites de mouvements hérités et stéréotypés”, elle s’incarne selon Morizot de manière très variée dans le vivant : il cite les oiseaux mais on peut aussi penser aussi à la formidable intelligence d’une pieuvre (cf. le documentaire La sagesse de la pieuvre) : l’animal est redoutablement intelligent au sens défini plus haut ; seulement, l’espèce n’a pas développé de mécanisme de transmission des savoirs, contrairement aux baleines ou aux félins. Comme la mère meurt à la naissance de ses œufs, chaque bébé pieuvre doit tout réapprendre seul : se nourrir, se cacher, se protéger des prédateurs, chasser.
Citant l’évolutionniste Simon Conway Morris, Morizot estime que l’intelligence est apparue des centaines de fois dans l’évolution, et qu’il y a d’une certaine façon des convergences évolutives sur ce point, l’intelligence étant un “Bon Truc Evolutif” (Dennett). Des solutions nouvelles et créatives (telles que l’intelligence) sont en effet redécouvertes, plusieurs fois, par hasard (mais un hasard contraint par les conditions de l’évolution), pour sans cesse répondre à l’énigme foisonnante qu’est de vivre. En théorie de l’évolution, il est consensuel de dire que des organismes vivants soumis à des pressions sélectives similaires développeront, parfois séparément et à des milliers d’années d’intervalle, des solutions évolutives similaires. Le paradoxe de l’évolution, c’est qu’il mélange des mutations génétiques qui se produisent par hasard (la plupart ne conférant aucun avantage particulier, et disparaissant rapidement) et des pressions sélectives (pour trouver de la nourriture et se reproduire) qui aboutissent à des résultats qui eux n’ont rien d’hasardeux. Est-ce pour autant une suite de contraintes déterminées ?
La théorie de l’évolution selon Morizot
Pour défendre l’idée que les autres animaux ne nous sont pas inférieurs, ni dépourvus de libertés, Morizot fait en effet un long détour par la théorie de l’évolution dont il semble bien maîtriser les principaux concepts. Pour Morizot, il faut éviter de tomber dans une sorte “d’adaptationisme radical”, selon lequel tout organe existe précisément pour une fonction mise en place par l’évolution par sélection naturelle. Selon lui, le vivant ne peut se réduire à l’invention technique d’un ingénieur : pour un même organe, plusieurs fonctions sont possibles, elles ont pu changer avec le temps, elles changeront encore peut être, et restent disponibles pour différents usages. Du reste, si on se projette dans un temps très long, un animal qui nous semble aujourd’hui bête ou inutile (mettons, un batracien commun, voire une bactérie), deviendra peut être dans plusieurs millions d’années le summum de la culture, de l’éthique et de l’esthétique, de la vie en société. C’est bien par là que nous sommes passés !
Pour Morizot, l’évolution est un héritage biologique ancré dans l’histoire : celle de l’espèce d’abord, celle de l’individu ensuite. Morizot entend donc “ouvrir la voie à une philosophie du vivant qui assume les héritages biologiques sans les transformer en déterminisme” : l’évolution ne produit pas seulement des contraintes naturelles telles que les lois de la reproduction, la nécessité d’absorber de l’eau et des calories pour survivre ou la fonction de l’œil, elle produit aussi des nouveautés, des usages créatifs de tel ou tel organe.
De cela, le philosophe prend de multiples exemples, mais quiconque ayant déjà regardé un documentaire animalier en trouvera lui-même. Ainsi de la plume de l’aigrette ardoisée africaine (un oiseau), qui utilise ses plumes pour faire de l’ombre attirant les poissons à la recherche d’un nénuphar : une lecture purement adaptationiste (la plume a été sélectionnée par l’évolution pour la thermorégulation, la parade ou le vol) passerait à côté des usages inventifs qu’une telle espèce fait de cet organe. De même, il n’y a pas une seule fonction au hurlement du loup (ce que Morizot montre abondamment dans ses multiples récits de pistage) : le cri du loup “emmagasine dans ses propriétés l’histoire des différentes fonctions qu’il a connues (au sens de ses effets sous pression de sélection) et il est chaque jour disponible pour être subverti vers une multiplicité d’usages encore inouïs ».
Comme d’habitude avec la vie, chacun fait ce qu’il veut de ce que l’évolution a fait de lui, chacun subvertit, détourne, et invente à partir de la richesse de ses héritages.
L’évolution n’est donc pas seulement la “théorie de l’évolution par variation-sélection” mais, selon une belle expression de Morizot, elle est la « sédimentation de dispositifs dans le corps, produits par une histoire : des ascendances. (…) Les ancestralités animales sont des comme des spectres qui vous hantent, en remontant à la surface du présent”
Evoquant encore les laissées (fientes) des loups observées lors d’un long pistage, Morizot invite à se libérer d’interprétations trop simplistes mais surtout trop systémiques, trop systématiques : que ce soit le réductionnisme biologique (les laissées sont des stimuli qui se déclenchent par des conditionnements opérants), anthropomorphisme simpliste qui reviendrait à interpréter tout signe animal comme un effet symbolique d’une créativité culturelle (les laissées sont des blasons que les loups utilisent pour marquer leur territoire et leur appartenance à la meute) ou, à l’inverse, naturalisation de l’humain (nous sommes également des loups, nos blasons sont des laissées).
Renouer avec le vivant
À partir de là, l’animalité humaine n’a plus rien à voir avec la bestialité, la férocité, le grossier… Elle est faite d’ascendances et d’affects animaux qui peuvent être déclinés ou subvertis, mais qui continuent de s’exprimer jusque dans nos comportements les plus quotidiens, les plus exigeants, les plus riches… Les ascendances animales sont partout (…) Quelle joie d’être un animal, alors.
Il est à noter que Morizot ne défend nullement une sorte d’égalitarisme entre tous les vivants : bien au contraire, il consacre de longues pages à explorer les formes de beauté et d’expressivité utilisées par les espèces animales qui n’ont pas comme nous développé de langage articulé et conceptuel : l’expressivité du visage d’un chimpanzé, du masque d’un loup ou du regard de la gazelle. Nous sommes (parfois très) différents mais néanmoins tous cohabitants de la même planète, embarqués dans la même aventure du vivant : l’enjeu est donc de (re)nouer des relations avec les autres espèces, et non pas de tomber dans l’anthropomorphisme en tentant d’en faire des citoyens sujets de droit d’une démocratie inclusive : le philosophe se montre d’ailleurs assez critique avec les antispécistes.
…Mais comment ?
Développer la sensibilité au vivant ; apprendre à traduire les signes des autres espèces (le cri d’un oiseau, le regard d’un chien, la course d’un cerf…) comme on traduit, sans jamais y parvenir parfaitement, d’autres mots dans d’autres langues (le spleen anglais, le dasein ou le schadenfreude allemand, la saudade des Brésiliens…), car pour les autres espèces, nous sommes toujours des étrangers comme elles sont des étrangers pour nous, en même temps que nous vivons côte à côte : nous sommes les uns pour les autres des aliens familiers ; acquérir un savoir du vivant, foisonnant et riche parce qu’issu du terrain, d’une enquête continue, immersive, qui ne se réduit pas aux protocoles expérimentaux et aux articles peer-reviewed ; apprendre, en soi, non pas à dompter ses “pulsions fauves” dans une morale rigide du cocher, mais à dialoguer avec elle dans une logique spinoziste, les pulsions de tristesse comme les pulsions de joie étant perçues comme des trajectoires ascendantes et descendantes plutôt que comme des parties de l’être ; et, hors de soi, à entretenir ce même dialogue avec le vivant, cette même attention qui produit ce que Morizot appelle des égards ajustés. Bref développer l’attention à la vie !
On le voit, le philosophe ne manque pas d’idées pour exprimer l’importance qu’il accorde à la nécessité urgente, vitale au sens propre, de développer une sensibilité au vivant, car cette insensibilité est pour lui le principal ferment de la crise écologique. Ce faisant, Morizot peut laisser sur sa faim le lecteur en quête de solutions définitives, binaires, de concepts clefs en main, applicables à toute situation. Car il ne cherche justement pas à donner des solutions binaires. Précisément, c’est pour lui la situation qui doit entraîner la bonne attitude, l’attitude ajustée. Et l’incertitude fait partie de l’attitude ajustée, puisqu’elle entraîne le “barbouillement moral des empathies multiples et contradictoires”.
Dans la diplomatie réelle, la diplomatie des interdépendances, celle au service des relations, et pas d’un des membres de la relation contre l’autre, la navigation négative est un art important, un art quotidien. La boussole est claire : le repère qu’il faut fuir, celui donc on doit toujours s’éloigner pour être ramené en pleine mer d’incertitude, c’est-à-dire à l’abri, c’est la tranquillité d’âme, le sentiment de la pureté morale. C’est le sentiment d’être au service de la Juste Cause exclusive (pour les loups innocents contre les exploitants malhonnêtes), celui de la Sainte Colère (contre le fauve voleur, le sadique), celui de la Vérité révélée. La conviction d’être parmi les Bons contre les Méchants, des Justes contre les Bêtes, des innocents contre les criminels, des Nobles Sauvages contre les infâmes humains, ou de la Civilisation contre la Sauvagerie.
Ainsi, s’agissant des relations entres loups, bergers et brebis, Morizot affirme : “on voit à quel point l’alternative habituelle, à savoir stigmatiser le pastoralisme en bloc comme s’il était l’ennemi de la biodiversité, ou l’adouber en bloc comme s’il était le maillon essentiel de la préservation des paysages, ne tient pas : tout dépend des pratiques, et il faut penser une transformation de l’usage pastoral des territoires, qui aille dans le sens d’une protection accrue des prairies, des loups et du métier lui-même (…) les parcours techniques qui protègent le mieux les milieux sont aussi ceux qui protègent le mieux les brebis des loups, et des brebis protégées impliquent moins de politiques réactives de destructions des loups, qui sont le pis-aller lorsque la protection active au troupeau n’est pas un succès”. Dans le même genre, “l’alliance entre abeilles et apiculteurs consiste une diplomatie entre d’un côté l’agrobusiness et ses “exigences” de rendement, et de l’autre la biodiversité sauvage du milieu (microfaune des sols et pollinisateurs en général), qui pâtit de l’extractivisme”.
Un livre politique ?
Avec ses concepts d’attention au vivant et de crise de la sensibilité, un militant écologiste pourrait facilement reprocher à Morizot de dépolitiser l’écologie.
Certes, le propos de Morizot n’est pas directement politique. On l’a dit, l’auteur est hostile aux repères moraux simplistes et systématiques : on ne trouvera donc pas dans son livre une défense du véganisme contre les carnivores, ni une apologie de l’égalitarisme entre tous les vivants (quelle égalité entre vous et les bactéries de votre système digestif ?), pas plus qu’un désir de retour à l’animisme de la “nature sacrée” ou même une critique de la chasse. De plus, il critique l’antispécisme comme réducteur, car fondé sur le concept de “personne sentiente” et donc rejouant selon lui le dualisme sacré/profane : les animaux sentients devraient être considérés moralement comme des humains, tandis que ceux qui ne sont pas personnifiés (les milieux, les végétaux, les animaux non sentients), sont voués à rester de la “nature-ressource”.
Selon lui, il n’est pas interdit d’exploiter un milieu, mais “plus vous exploitez un milieu, plus vous lui devez d’égards, plus vous prenez à la terre, plus il faut lui restituer”. Les non-modernes aussi “tuent, mangent, chassent, rusent, exploitent, cueillent, mais aussi sèment, récoltent leur sacré”. Cependant leurs relations avec le vivant ne sont jamais dépourvues d’égards, égards que la modernité perçoit comme infantiles et irrationnels.
Pour autant le livre de Morizot n’est pas apolitique : l’auteur a bien un adversaire politique, ce qu’il nomme l’extractivisme moderne, où la “Nature” n’est perçue que comme entité abstraite, matériau exploitable, au mieux un environnement dont le but unique est de satisfaire les besoins de l’homme, dont éventuellement on soustrait quelques minuscules parcelles (espèces protégées, réserves naturelles), tout en ne changeant rien à notre conception globale des autres êtres vivants.
Pour y remédier, la sensibilité au vivant est une étape cruciale, mais il faut ensuite “politiser l’émerveillement, en faire le vecteur de luttes concrètes pour défendre le tissu du vivant, contre tout ce qui le dévitalise. (…) Sans cette joie vécue et sensible à l’idée de l’existence du vivant en nous et hors de nous, comment lutter contre les puissances mortifères des lobbys du pétrole et de l’agrobusiness ? Pour s’engager, nous avons besoin de l’indignation pour armer l’amour, mais nous avons besoin de l’amour du vivant pour maintenir à flot l’énergie, et savoir quel monde défendre”. Ainsi, il ne faut dénier ni la lutte radicale comme une immaturité romantique (on rappellera à cette occasion que Morizot est l’un des fondateurs des Soulèvements de la Terre), ni la négociation comme une compromission avec le “système”, mais bien “articuler de manière organisée, avec des cibles appropriées, la négociation et la lutte”.
Tout ceci étant dit, cela reste fort vague dès qu’on voudrait le traduire en décision politique plus concrète : clairement, Manières d’être vivant n’est pas un essai politique ni un pamphlet militant ! mais bien un livre de philosophie de l’écologie. Ainsi on peut questionner le livre par ses non-dits, c’est-à-dire les questions politico-économiques très sous-jacentes, mais que le livre n’évoque pas, ou très peu. Non pas qu’on demande à un philosophe d’être en même temps économiste, agronome, démographe, climatologue, mais du moins, sans doute, d’avoir une idée des questionnements (ouverts) qu’impliquent ses positions d’un point de vue strictement collectif, commun, donc politique. Car le barbouillement moral est bien compréhensible dans une observation, à petite échelle, d’un milieu tel que le pastoralisme, ou le pistage d’une meute de loups. Mais tout le monde ne peut être berger, ni pister des loups. Comment traduire cela en politique, où gouverner c’est choisir (Mendès-France) ?
Par exemple : comment traduire la notion d’égards ajustés en décisions politiques ? peut-on nourrir le monde avec de l’agroécologie ? Si oui comment ? Si non faut-il revenir à Malthus ? La sensibilité au vivant peut-elle s’apprendre à l’école ? Peut-elle quelque chose contre la crise climatique, qui est globale ? Comment traiter politiquement l’urbanisation croissante où la plupart des humains vivent dans des villes de béton sans relations directes avec d’autres vivants qu’eux-mêmes ? Les Gilets jaunes s’opposaient en premier lieu à une taxe sur les émissions de carbone : fin du mois contre fin du monde ? Etc.
Ce n’est qu’en toute fin d’ouvrage que Morizot évoque, timidement et trop rapidement, le fait que la notion d’égards ajustés ait des implications politiques plus directes, puisqu’on peut la traduire en normes politico-juridiques avec une gradation allant par exemple de l’interdiction totale d’exploiter en laissant un milieu en libre évolution, à une exploitation “raisonnée”, mais ce point crucial (qu’est-ce qu’une exploitation raisonnée ? à quel moment une ferme passe dans la logique de l’agrobusiness ? y a-t-il un chiffre d’affaires maximum ?) est très peu développé.
Note de lecture : Cours de philosophie politique, par Blandine Kriegel

Cours de philosophie politique promet ce que le titre annonce : il s’agit d’un excellent petit condensé sur les thème des démocraties, synthétisant dans une langue absolument limpide les enjeux et les débats de chaque point important : l’Etat de droit, les droits de l’homme, républiques et démocraties, Etats-nations et nationalismes, etc. S’agissant de la retranscription de séances de cours que l’autrice (une philosophe et politologue assez peu connue) a donné à l’Université de Moscou dans les années 1990, il s’agit d’une vraie réussite. Bien sûr, le texte n’a rien de très original et celui qui a déjà suivi quelques leçons en matière de droit constitutionnel ou de philosophie politique n’apprendra pas grand chose. Mais il a le grand mérite de la synthèse courte, claire et précise. Lire la suite
Note de lecture : Le monde sans fin (Blain & Jancovici)
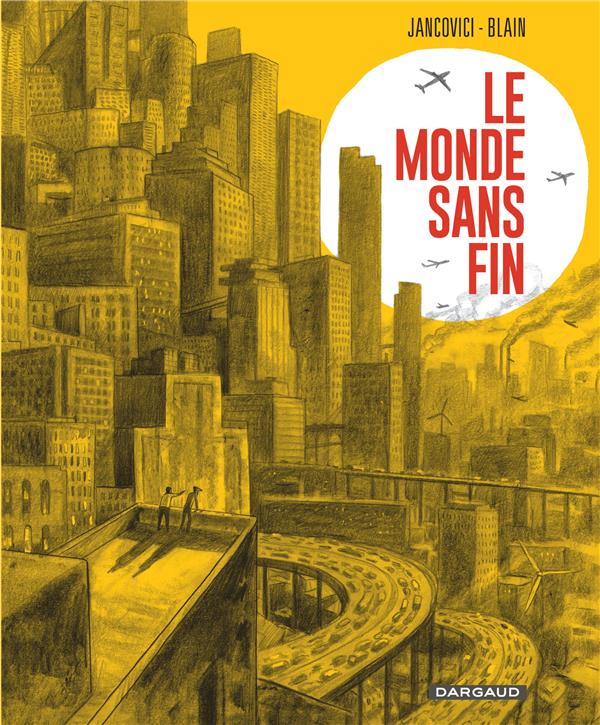
Bon, finalement, je chronique une deuxième bédé…![]()
Les auteurs
Christophe Blain est bien connu dans le monde de la bédé. C’est le seul auteur à avoir remporté deux fois le prix du meilleur album du festival d’Angoulême. Je n’ai lu que son œuvre la plus connue : Quai d’Orsay, une chronique diplomatique sur la vie du ministère des Affaires d’Etrangères sous Dominique de Villepin. Dit ainsi, ça ne semble pas très excitant, mais la série est géniale, foncez ! Le dessin de Blain est toujours drôle, propre, original. Il convient parfaitement au projet ici chroniqué. Lire la suite
Note de lecture : l’Empire, une histoire politique du christianisme (1/2)
J’ai écrit une quinzaine de notes de lectures sur ce blog mais c’est la première fois que je chronique une bande dessinée. Ce n’est pas faute d’en lire (beaucoup !) mais elles ne se prêtent pas au genre d’analyse que j’aime faire. Cela dit, L’Empire (sous titre : Une histoire politique du christianisme) n’est pas tout à fait une bédé. Le scénario en a été entièrement rédigé par Olivier Bobineau qui est en fait un… sociologue et politologue, spécialiste des religions et membre du groupe Sociétés, Laïcités, Religions du CNRS. Aux dires de l’auteur, L’Empire “est le fruit de vingt années de travail scientifique et académique”.
L’ambition de l’ouvrage (en deux tomes publiés, un à paraître) est énorme, presque démesurée : il s’agit d’écrire une histoire du christianisme des origines à nos jours sous l’angle des rapports de pouvoirs. Je dirais un mot rapide des dessins de Pascal Magnat : ils servent utilement le propos en l’illustrant ou avec une touche d’humour, mais ils n’ont rien d’extraordinaires non plus. Dans tous les styles, j’ai vu beaucoup mieux. Néanmoins, ils ne gâchent rien, et rendent évidemment la lecture plus agréable que s’il eut s’agit d’un essai (cela reste une bédé !) Lire la suite
Note de lecture : Mémoires vives, par Edward Snowden
L’auteur
Est-il besoin de présenter le lanceur d’alerte le plus célèbre de la planète ? En 2013, Snowden a acquis une attention médiatique internationale en divulguant des documents classifiés sur la manière dont la NSA (National Security Agency) américaine espionnait le monde entier, y compris les Américains. Il faut reconnaître à l’auteur un courage phénoménal puisqu’il a sacrifié sa carrière, son salaire confortable, son pays, la plupart de ses relations familiales et amicales restées aux Etats-Unis pour pouvoir divulguer ce qu’il a divulgué : en 2021, poursuivi pour des crimes fédéraux aux Etats-Unis, il vit toujours en Russie où il a obtenu le droit d’asile avant de s’y marier. Lire la suite
Note de lecture : La nature du social (L. Cordonier)

A propos de l’ouvrage
La nature du social (2018) est un ouvrage qui traite de questions fondamentales sur le rapport entre nature et culture et l’explication du comportement humain en général. Laurent Cordonier, sociologue, a pour objectif de créer des ponts entre des disciplines que l’on imagine souvent irréconciliables : la sociologie (et les sciences sociales en général) et les « sciences de la nature humaine » (psychologie cognitive, biologie évolutionniste).
Lire la suiteNote de lecture : Sapiens, une brève histoire de l’humanité (Y. N. Harari)
Un bon essai est un mélange entre une fiction et un article scientifique : il doit être aussi agréable à lire que le premier tout en s’approchant de la rigueur du second. Ce qu’on attend d’un essai, c’est une langue claire et fluide, mais néanmoins des arguments, si possible fondés, voire des idées nouvelles. Un essai peut même se permettre de prendre beaucoup de hauteur par rapport aux sujets très circonscrits qui sont l’objet des articles scientifiques, quitte à être démesurément ambitieux ou très original : ce n’est pas si grave.
Lire la suiteNote de lecture : Le capitalisme sans capital (J. Haksel et S. Westlake)

Ce livre écrit en 2018 est probablement le meilleur livre d’économie contemporaine que j’ai lu ces cinq dernières années, au moins depuis Le commerce des promesses de Pierre-Noël Giraud (dont j’avais fait plusieurs chroniques sur ce blog).
Lire la suiteNote de lecture : Les Déshérités, de François-Xavier Bellamy

Comme professeur de lycée, je suis intéressé depuis longtemps par les débats liés à l’école et aux questions pédagogiques. J’ai publié plusieurs articles sur le sujet, ici même, notamment sur la question du niveau des élèves (lien), des valeurs transmises à l’école (lien), du lien entre école et démocratie (lien) où je commentais notamment un texte de Laurent Lafforgue, de propositions pour l’école (lien) ou encore des réformes de l’université (lien).
J’ai donc lu avec intérêt le court essai de François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie (et désormais connu du grand public puisqu’il est tête de liste LR aux élections européennes) publié en 2014 : Les Déshérités ou l’urgence de transmettre. Le titre étant une référence assez évidente aux Héritiers (1964) de Bourdieu et Passeron (ou plutôt : contre Bourdieu et Passeron), il m’a interpellé. Très honnêtement, venant d’un esprit qui s’affirme conservateur, je m’attendais à une énième plainte un peu réactionnaire sur l’école qui ne transmet plus rien, la perte des valeurs, et les jeunes qui ne respectent plus leurs aînés et gnagnagna.
Lire la suiteNote de lecture : Le danger sociologique
L’ouvrage et les auteurs
Etienne Géhin est présenté sur la couverture comme un (ex) maître de conférences en sociologie. Avant cela, je n’avais jamais entendu parler de lui ; Gérald Bronner, en revanche, est plus connu du grand public, notamment pour ses analyses de la radicalisation et des théories du complot. Il a acquis récemment une notoriété médiatique relativement importante pour un sociologue.
Le contenu du livre
Le livre est un véritable plaidoyer pour la sociologie analytique, aussi appelée individualiste, ou encore compréhensive. Même s’il constitue une charge contre la sociologie holiste (ou structuraliste, ou culturaliste), le ton adopté n’a rien d’un pamphlet, comme certains médias l’ont prétendu (Le Monde, Les Inrocks). Il est plutôt constructif et adopte résolument une posture scientifique (la liste des références est assez fournie).
Note de lecture : la Facture des idées reçues
Voici un livre que j’ai lu sur les conseils d’une collègue. Il est écrit par un trader passionné d’économie et de politique (à priori plutôt négatif pour moi), mais ressemble à un ouvrage de vulgarisation dans la veine des « freakonomics« . Rappelons l’idée générale de cette approche de l’économie : prendre un sujet, même sans rapport avec les thèmes classiques, comme les drogues, la consommation de viande ou les limites de vitesse, et faire une analyse coûts/bénéfices pour montrer qu’on pourrait faire autrement (ie. beaucoup mieux) avec une autre approche du problème, et éviter ainsi « la facture des idées reçues ». Voici quelques idées retenues : Lire la suite
Un certain Juif, Jésus (6/12)
Un certain Juif, Jésus (5/12)

Le Sermon sur la montagne
Rappel : chacune des affirmations qui suivent est longuement justifiée par Meier au long de ses ouvrages et à l’aide des méthodes mentionnées supra. Comme indiqué précédemment, je me contenterai de les reprendre sans les justifier, à l’exception des débats les plus polémiques. L’ensemble de ma synthèse est déjà bien assez long comme ça ! Le lecteur intéressé voudra bien se reporter directement à la lecture du livre dont j’écris ici la note de lecture et des autres que je cite. Lire la suite
Un certain Juif, Jésus (4/12)
III. La vie d’un certain Juif : que peut-on dire de fiable sur Jésus de Nazareth ?
Après trois articles durant lesquels nous n’avons fait, au fond, que présenter les sources, les matériaux et la méthodologie de Meier, comme il le fait lui-même dans le tome I, venons-en au contenu plus précis des ouvrages, à savoir : la fin du tome I, qui concerne l’enfance de Jésus et des questions diverses (sa famille, son métier, son éducation, son lieu de naissance et de vie, etc.) ; le tome II, qui concerne son message religieux et sa relation avec Jean le Baptiste ; le tome III, qui concerne son entourage proche ou lointain, à savoir ses disciples et les foules qui le suivaient, ainsi que ses adversaires, pharisiens, sadducéens, esséniens ; le tome IV, qui concerne la relation de Jésus à la loi juive. Bref, tout ce que pouvons dire de fiable sur un certain Juif, Jésus, prophète Juif marginal de la Palestine du premier siècle et personnage historique ayant marqué la culture religieuse, artistique et intellectuelle occidentale dans des proportions uniques. Lire la suite
Un certain Juif, Jésus (3/12)
Un certain Juif, Jésus (2/12)
B. Trois intérêts de la recherche historique sur Jésus de Nazareth
Nous verrons trois grands types d’intérêts à la recherche historique sur Jésus, dont deux concernent aussi les non-croyants.
Premier intérêt (pour les croyants) : elle ancre la foi dans un passé objectif
Si c’est bien le « Jésus-Christ, Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu, engendré non pas créé » (cf. Symbole de Nicée-Constantinople) qui est l’objet la foi chrétienne et non pas le Jésus historique tel que la recherche parvient à le reconstruire, il n’en demeure pas moins que le lien entre Jésus historique et Jésus-Christ est évident : la foi chrétienne ne repose pas sur un vague sentiment subjectif ou des extases religieuses, mais sur certaines affirmations à propos d’un personnage historique ayant vécu, parlé, marché en Palestine au premier siècle de notre ère. Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI affirme clairement : « du point de vue de la théologie et de la foi dans leur essence même, la méthode historique est reste une dimension indispensable du travail exégétique. Car il est essentiel pour la foi biblique qu’elle puisse se référer à des évènements réellement historiques. Elle ne raconte pas des légendes comme symboles de vérité qui vont au-delà de l’Histoire, mais elle se fonde sur une histoire qui s’est déroulée sur le sol de cette terre. Le factum historicum n’est pas pour elle une figure symbolique interchangeable, il est le sol qui la constitue : « Et incarnatus est » – « Et il a pris chair » – par ces mots, nous professons l’entrée effective de Dieu dans l’histoire réelle. »
Second intérêt : pour toute personne cultivée qui veut mieux comprendre la vie de Jésus de Nazareth
« Je soutiens, écris Meier, que la recherche du Jésus historique peut être très utile si on veut une foi qui cherche à comprendre, une foi en quête d’intelligence, autrement dit si on veut faire de la théologie dans un contexte contemporain. La théologie des périodes patristique et médiévale vivait dans la plus parfaite ignorance du problème du Jésus historique, car elle fonctionnait dans un contexte culturel où n’existait pas l’approche historico-critique qui marque nos esprits occidentaux modernes. La théologie est un produit culturel ; depuis l’époque des Lumières, notre culture occidentale se trouve imprégnée de l’approche historico-critique ; par conséquent, pour être crédible, la théologie peut fonctionner dans cette culture et avoir quelque chose à lui dire uniquement si elle intègre dans sa méthodologie une approche historique ».
Plus précisément, Meier soutient à raison que la recherche sur le Jésus historique permet d’éviter bien des dérives et des erreurs. Il en donne quatre exemples :
« 1) Il existe des démarches qui visent à réduire la foi au Christ à un message codé dépourvu de contenu, à un symbole mythique ou à un archétype intemporel. La recherche du Jésus historique s’oppose à de telles démarches en rappelant simplement aux chrétiens que la foi au Christ n’est pas une vague attitude existentielle ou une manière d’être dans le monde. La foi chrétienne est l’affirmation de l’existence d’une personne particulière et l’adhésion à cette personne, une personne qui a fait et dit des choses particulières en un temps et en un lieu particulier de l’histoire humaine. (…) Si la recherche ne peut fournir le contenu essentiel de la foi, elle peut néanmoins aider la théologie à donner à ce contenu davantage de profondeur concrète et de couleur [NB : Meier fait ici référence aux théories de la non-existence de Jésus, sur lesquelles nous reviendrons].
2) Il existe aujourd’hui des chrétiens sincères qui ont un penchant faussement mystique ou docétique : ils ont tendance à gommer la réalité humaine de Jésus en se targuant « d’orthodoxie » pour insister sur sa divinité (en fait, un monophysisme larvé). La recherche lutte contre cette tendance, en affirmant que le Jésus ressuscité est bien la même personne que ce Juif qui a vécu et qui est mort au Ier siècle en Palestine, une personne vraiment et pleinement humaine comme n’importe quel être humain, avec toutes les conséquences contraignantes que cela implique.
3) Il existe des démarches qui tendent à « domestiquer » Jésus, au service d’un christianisme confortable, respectable et bourgeois. Dès qu’elle s’est mise en place, la recherche du Jésus historique a eu tendance à contrer ce penchant en soulignant le côté dérangeant et non-conformiste de Jésus : par exemple, sa fréquentation de gens « peu recommandable » pour la société et la religion en Palestine, sa dénonciation prophétique de l’observance religieuse extérieure qui ignore ou étouffe l’esprit intérieur de la religion, son opposition à certaines autorités religieuses, notamment aux membres du sacerdoce de Jérusalem.
4) Mais, pour ne pas laisser croire que « l’utilisation du Jésus historique » va toujours dans le même sens, il est bon de souligner que, contrairement aux affirmations de Reimarus et de beaucoup d’autres après lui, le Jésus historique ne se laisse pas non plus facilement récupérer au service de programmes politiques révolutionnaires. Par comparaison avec les prophètes classiques d’Israël, le Jésus historique est remarquablement silencieux sur de nombreux sujets sociaux et politiques brûlants de son époque. Pour faire de lui un révolutionnaire politique de ce monde, il faut déformer les données exégétiques ou forcer l’argumentation. Tout comme la bonne sociologie, le Jésus historique subvertit non seulement certaines idéologies mais toutes les idéologies, y compris la théologie de la libération. »
Les deux derniers points relèvent sans doute un des intérêts majeurs de la recherche historique sur Jésus. Car Jésus de Nazareth est certainement l’un des personnages historiques qui a été le plus sujet à récupérations : de nombreux auteurs, de tous bords et de tous courants, croyants ou non-croyants, ont utilisé des éléments évangéliques pour brosser un portrait de Jésus prétendument historique. Tour à tour, on a donc eu un Jésus violent révolutionnaire (Reimarus) voire quasi-marxiste (c’est la vision d’un Fidel Castro ou d’un Chavèz), un Jésus militant panarabe (Yasser Arafat voyait en Jésus le premier militant Palestinien, rien que ça), un Jésus philosophe maître de sagesse, comparable à Socrate ou à Bouddha (Frédéric Lenoir est le grand défenseur de cette conception en France), un Jésus prophète apocalyptique restaurateur de l’Etat d’Israël (E.P Sanders), un Jésus précurseur du libéralisme (Charles Gave, Scotty McLennan, Jerry Wilde), un Jésus philosophe rationnel moraliste (Thomas Jefferson), et même un Jésus magicien homosexuel, un Jésus anarchiste opposé aux institutions religieuses de son temps, etc. Tous ces auteurs ont en commun de proposer une vision déformée, partielle et partiale de Jésus de Nazareth, plaquant leurs propres conceptions philosophiques et politiques sur ce prophète Juif du Ier siècle qui a si profondément marqué la civilisation occidentale.
Si la recherche historique est limitée, elle reste hautement plus fiable que cette littérature biaisée, et permet d’écarter les interprétations les plus fantaisistes, qui ne reposent sur aucune donnée biblique solide, sur aucun argument exégétique crédible. La recherche historique cherche à connaître ce qu’on peut savoir « vraiment » sur Jésus de Nazareth en écartant les interprétations ou récupérations politiques, philosophiques ou théologiques quelles qu’elles soient (catholiques, athées, marxistes, libérales…) qui proviennent d’Occidentaux du XX ou du XXIème siècle.
Troisième intérêt : combattre le fondamentalisme.
Parmi les dérives possibles figure en bonne place le fondamentalisme chrétien. Ce dernier consiste à lire littéralement la Bible, c’est-à-dire à considérer que tout ce qui y est raconté est strictement historique. On sait bien sûr à quoi mène une telle position dans la lecture d’un texte comme la Genèse : c’est le créationnisme. Dans le cas du Nouveau Testament, les mêmes problèmes se posent. Par exemple, lorsque au chapitre 3 Luc raconte que « le Saint-Esprit descendit sur lui [Jésus] sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé : en toi j’ai mis toute mon affection », le fondamentaliste considérera que tout s’est réellement passé ainsi.
La recherche historique a pour effet d’écarter l’interprétation fondamentaliste, et nous pouvons en donner trois raisons :
1. La première et la plus évidente, c’est qu’un scientifique, en tant que scientifique, ne peut accepter l’idée de faits surnaturels. L’historien effectuant des recherches sur Jésus peut tout à fait avoir la foi mais ne peut pas, en tant qu’historien, se prononcer sur la réalité des miracles racontés dans les Évangiles. Il ne peut certainement pas affirmer par exemple, que Jésus est effectivement ressuscité. Une telle affirmation relève de la foi. La distinction entre « ce que je sais par la raison » et « ce que je crois par la foi » est d’ailleurs parfaitement orthodoxe puisqu’elle vient de Saint Thomas d’Aquin. Cela ne veut cependant pas dire qu’on doit « retirer » des Évangiles tout ce qui a trait au merveilleux, comme l’a fait Thomas Jefferson au XIXème siècle en réalisant une Bible expurgée de tout miracle. En effet, au plan de l’histoire, si l’on ne peut étudier la réalité des miracles, on peut étudier la foi dans les miracles. Dire que Jésus a réalisé des miracles est une affirmation théologique, mais dire que de nombreux personnes du temps de Jésus ont cru, ont admis, ont pensé qu’il réalisait des miracles est une affirmation qui peut parfaitement être étudiée par la recherche historique. Il faut donc distinguer la foi (théologique) et l’histoire de la foi (historique). Meier ne répond pas à la question théologique (métaphysique) de savoir si des miracles sont possibles, ou si Jésus en a réalisé. Mais il s’intéresse longuement à la question de savoir si des foules du temps de Jésus ont effectivement considéré qu’il réalisait des miracles, ou s’il s’agit plutôt d’ajouts postérieurs du christianisme primitif.
2. Seconde raison. Les Évangiles, et la Bible en général, ne sont pas des récits visant à l’historicité « objective ». Bien sûr, elles contiennent des éléments historiques (sinon la recherche historique n’aurait aucun intérêt), c’est-à-dire des personnages, des lieux, des noms, des discours et des évènements dont la réalité peut être attestée par la recherche. L’Ancien Testament est aussi l’histoire racontée du peuple Juif à travers les siècles, ce qui implique des noms de rois, de batailles, des généalogies, des prescriptions juridiques, etc. De même, le Nouveau Testament raconte l’histoire de Jésus de Nazareth (Évangiles), de ses premiers disciples (Actes des Apôtres) et des enseignements des premiers chrétiens (lettres de Paul), qui peut parfaitement être étudiée par la recherche historique. De plus, Luc en particulier prétend s’être précisément renseigné sur ce qu’il écrit en rassemblant des témoignages, ainsi qu’il déclare dans son introduction : « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. »
Malgré cela, les chrétiens savent bien qu’avant d’être un livre d’histoire, la Bible est un livre de foi écrit par et pour des croyants, ou des incroyants appelés à le devenir. Elle vise à transmettre la foi et à conforter dans la foi, à édifier la communauté des croyants. Les Évangiles sont soigneusement composés par chaque évangéliste pour conduire à la foi. Les récits composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean « relisent toute la vie de Jésus à la lumière de la résurrection, au point que bien des scènes évangéliques deviennent un petit évangile ou un petit « kérygme » particulier qui s’achève sur une confession de foi. Par un biais précis la totalité de l’Évangile résonne en chaque scène. » (Bernard Sesbouë). Prenons un seul exemple : lorsque Jean raconte les Noces de Cana, il ne dit pas le nom des mariés mais précise le nombre des jarres (6), chiffre symbolique auquel il accorde une grande importance, car il signifie l’imperfection (le chiffre parfait étant 7), donc l’imperfection de la loi juive ancienne que Jésus vient renouveler. Ce n’est pas non plus par hasard que Jean précise que le miracle a eu lieu trois jours après la première manifestation publique de Jésus (son baptême par Jean le Baptiste), ce que Thomas d’Aquin interprète comme une référence au prophète Osée : « Après deux jours, il nous rendra la vie ; le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence (Os, 6,2).
On voit bien que même si les Évangiles contiennent des éléments historiques (ici, un récit de mariage), la plupart des récits sont composés et interprétés à l’aide de symboles théologiques. Une grande partie du travail homilétique consiste d’ailleurs à expliquer et interpréter ces symboles aux fidèles. Pourquoi ? Parce que les auteurs du Nouveau Testament (les évangélistes et Paul) veulent convaincre les Juifs de leur temps que Jésus est le Messie. De nombreux épisodes (ou péricopes, littéralement « découpage », terme désignant pour les exégètes un extrait formant une unité, une pensée cohérente) sont donc destinés à mettre en relation Jésus et les prophéties de l’Ancien Testament censées l’annoncer. Ainsi, l’épisode de la résurrection du Fils de la veuve de Naïm (Lc, 7) s’inspire de la résurrection par Élie du fils de la veuve de Sarepta (Rois, 17).
On a donc dans les Évangiles d’un côté « le fond », à savoir ce qui est raconté et peut être historiquement vérifiable, et de l’autre « la forme », c’est-à-dire la façon de raconter et ordonner les péricopes, suivant un projet théologique donné. On peut ici faire mention de l’antique doctrine des quatre sens de l’Écriture. Elle est très ancienne et remonte à la tradition judaïque de l’étude de la Torah (le Midrash). Dans l’exégèse chrétienne, on distingue ainsi :
- le sens littéral (« la lettre »), c’est-à-dire le sens issu de la compréhension linguistique de l’énoncé. C’est ce qui s’est vraiment passé, et que la science historique peut reconstituer partiellement ;
- les sens spirituels (« l’esprit »), traditionnellement au nombre de trois : le sens allégorique (interprétation d’un passage en fonction de la foi chrétienne en la divinité du Christ) ; le sens moral (ou tropologique) : interprétation d’un passage en vue de la conduite morale à tenir, en se concentrant sur les vertus ; le sens anagogique ou eschatologique : interprétation d’un passage en vue de l’avenir et de la fin des temps.
Historiquement, on peut distinguer deux Écoles théologiques : celle d’Alexandrie, qui privilégiait la méthode historico-littérale pour les textes saints ; et celle d’Antioche, qui privilégiait la méthode allégorique. Avec Raymond Brown, Meier a d’ailleurs écrit un livre à ce sujet. Prenons un exemple. Le passage de la naissance de Jésus peut être interprété de façon littérale (un ange est réellement apparu dans le Ciel pour guider les Bergers), de façon allégorique (la venue de Jésus annoncé par un ange symbolise sa royauté divine), morale (Dieu aime les hommes et leur envoie son Fils unique). Second exemple : la guérison d’un lépreux (Lc 5. 12-16). Dans le sens littéral, ce passage signifie que Jésus a réellement guéri un lépreux. Mais dans un sens symbolique, le lépreux symbolise l’exclusion sociale, voire le genre humain affaibli par le péché, et ce passage signifie alors que Jésus est venu pour tous les hommes, en particulier les plus pauvres. On pourrait aussi faire le parallèle avec l’Ancien Testament dans lequel les lépreux étaient tenus à l’écart de la société (Lv 14. 1-57).
Attention ! Il est essentiel de comprendre que sens littéral (le fond) et symbolique (la forme) ne s’opposent pas nécessairement. Ce n’est pas parce qu’un évènement est interprété ou raconté de manière symbolique qu’on doit en conclure ipso facto qu’il ne s’est pas réellement produit. Un évènement peut s’être réellement produit mais être « enjolivé » ou interprété en un sens symbolique par le rédacteur de la péricope. Symbolique ne veut donc pas nécessairement dire inventé ! Un exemple : le nombre des disciples choisis par Jésus (12) est hautement symbolique puisqu’il s’agit d’une référence aux douze tribus d’Israël ; il n’empêche que sur le plan historique, il est incontestable que Jésus avait bien autour de lui un cercle restreint de douze disciples, comme le montre Meier dans son tome III. D’ailleurs, l’Évangile de Jean est à la fois très symbolique et très historique (cf. infra). Ce qu’on peut tenir, c’est qu’un récit soit raconté avec force symboles théologiques doit nous inciter à la plus grande prudence avant de pouvoir conclure quant à l’historicité.
Tous les passages bibliques ne contiennent pas tous les sens, mais il ne faut pas négliger un sens par rapport à un autre, que l’on adhère ou non à la lecture symbolique, ie. à la foi des chrétiens. Ne tenir compte que du sens historique, c’est se condamner à ne pas comprendre le contexte et l’intention qui a présidé à l’écriture des Évangiles, donc à ne pas comprendre les Évangiles du tout ; ne tenir compte que des sens symboliques, c’est réduire à la Bible à une mystique alors qu’elle mentionne des personnages et des évènements réels, historiquement vérifiables. En résumé, et je m’appuie ici sur le livre Pour lire le Nouveau Testament d’Étienne Charpentier et Régis Burnet, les Évangiles sont tout à la fois un récit mis en forme de différentes manières (paraboles, récits de miracles, sentences, prédictions, sermons), une théologie sous forme de récit, le compte-rendu d’une expérience spirituelle et humaine, et un écrit qui répond aux besoins d’une communauté à un instant donné. Ils ne sont pas un pur poème déconnecté des réalités humaines historiques et ne sont pas non plus une biographie de Jésus. La lecture de la Bible nécessite donc un certain degré de subtilité. Tant l’approche rationaliste, qui ignore la dimension historique de la Bible, que l’approche fondamentaliste, qui ignore la dimension symbolique, éludent cette subtilité en lisant la Bible comme s’il s’agissait d’un livre purement symbolique, ou au contraire comme s’il s’agissait d’un livre purement historique.
3. Troisième et dernière raison. L’approche fondamentaliste ignore les différences, voire les contradictions que l’on trouve dans les Évangiles. Si tout ce qui est écrit s’est réellement produit, il ne devrait pas y avoir de contradictions. Le fait même qu’il y ait quatre Évangiles et non pas un seul devrait nous inciter à ne pas lire le texte littéralement ! Quatre Évangiles donc quatre regards sur Jésus. Quatre regards donc de nombreuses différences ou contradictions possibles, concernant soit les paroles de Jésus, l’ordre et le détail des évènements, le nom, la nationalité ou le nombre des personnes présentes, etc. Il serait impossible de lister ici toutes les différences/contradictions des Évangiles, mais citons-en quelques-unes :
A. Dans l’Évangile de Luc, l’annonce de la naissance du Christ (Luc 28), est faite à Marie par l’archange Gabriel : ce sont les premiers mots de ce qui deviendra la prière du « Je vous salue Marie ». Mais dans l’Évangile de Matthieu, l’annonce est faite par un songe à Joseph et Marie n’est pas concernée. Marc et Jean, quant à eux, n’évoquent pas l’enfance et la naissance de Jésus. D’ailleurs, Matthieu 2 évoque la naissance dans une « maison » alors que Luc 2 parle d’une étable, dans une mangeoire (image retenue par la tradition chrétienne). La date de naissance même de Jésus est contradictoire : en Matthieu 2, 1, Jésus est né « au temps du roi Hérode » donc au plus tard en – 4 av. J.C., alors qu’en Luc 2, 2-6, c’est au moment du recensement effectué par le gouverneur Quirinius, donc en +6 av .J.C., que Marie se trouva enceinte et qu’elle « elle enfanta son premier-né ». Enfin, il y a des contradictions entre la généalogie de Jésus par Luc et celle par Matthieu.
B. Les synoptiques s’accordent sur une vie publique de Jésus se déroulant sur une année, essentiellement en Galilée. Le quatrième Évangile, au contraire, l’étale sur plusieurs années puisque trois fêtes de Pâques différentes sont mentionnées. Jésus monte plusieurs fois à Jérusalem, au lieu d’une seule fois comme dans les synoptiques. Pour continuer dans les différences entre les synoptiques et Jean, on remarque que ce dernier a un regard positif sur la mère de Jésus (jamais nommée) là où les synoptiques, et surtout Marc, témoignent d’une relative incompréhension de sa famille, y compris sa mère.
C. Jésus a-t-il demandé à ses disciples d’aller vers les païens ? Matthieu fournit des réponses contradictoires. En 10,5 il rapporte la parole de Jésus : « Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. » Mais en Matthieu 28, après la résurrection, il dit le contraire : « Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». De même, Marc 6 rapporte que Jésus prescrit à ses disciples de ne prendre qu’un bâton alors que Matthieu 10 écrit « ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton ».
D. De façon générale, l’ordre et le détail précis des évènements racontés se contredisent souvent : dans l’Évangile selon Matthieu, la guérison d’un lépreux (8, 1-4) eut lieu avant la guérison de la belle-mère de Simon (Pierre) (8, 14-15), alors que dans l’Évangile selon Marc, c’est d’abord la belle-mère de Simon qui fut guérie en premier (1, 29-31) ; à propos de certains miracles, Matthieu 8 parle de « deux démoniaques » alors que Marc 5 évoque « un homme » ; Matthieu 20 rapporte une guérison de deux aveugles (aux noms inconnus) alors que Marc 10 n’en rapporte qu’un, nommé Bartimée ; pour le même évènement, Matthieu 15 parle d’une « femme cananéenne » alors que Marc 5 évoque une « femme grecque, syro-phénicienne ».
Nous pourrions continuer la liste longtemps. La plupart de ces contradictions sont mineures car elles concernent des détails patronymiques ou spatio-temporels secondaires ; d’autres sont plus importantes pour la foi chrétienne, comme par exemple la question des frères et sœurs de Jésus, celle de savoir si Jésus a voulu fonder une Église ou encore plus importante, s’il s’est considéré lui-même comme le Fils de Dieu. Nous reviendrons ultérieurement sur ces questions.
Pourquoi y-a-t-il des contradictions ? On peut penser bien sûr que la façon de raconter un évènement diffère selon la personne qui raconte, y compris pour un évènement simple comme un accident de voiture ; les témoignages sur Jésus sont restés longtemps oraux avant d’être mis par écrit, et la mémoire peut jouer des tours, les témoins être plus ou moins fiables, etc. Quatre récits anciens composés entre 30 et 60 ans après les évènements ne peuvent donc que comporter des variantes. A la limite, c’est même une preuve de l’historicité des Évangiles : des récits rigoureusement identiques donneraient l’impression d’avoir été composées par une main unique, un faussaire.
Plus profondément, il y a des raisons théologiques aux différences et contradictions entre les Évangiles. Chaque évangéliste écrit selon son projet propre. On pourrait s’attarder longuement sur ce point mais contentons-nous de donner les éléments clés, bien connus des biblistes. A chaque fois nous rappellerons brièvement ce qu’on peut dire de l’auteur de l’Évangile (sachant que l’identité exacte est toujours délicate à établir et en partie spéculative), avant de s’attarder sur son projet théologique. On trouvera plus de détails dans le livre de Burnet et Charpentier, déjà cité.
- Marc est un proche de l’apôtre Pierre, son interprète, d’après Papias de Hiéropolis qui l’atteste vers 150. Les Actes des apôtres et les lettres de Paul font également état d’un « Jean, surnommé Marc » (par ex. Ac 12,25/Col 4,10). Il aurait donc accompagné Paul avant de suivre Pierre. Marc ne serait alors pas son vrai nom mais un surnom romain (Marcus) issu de ses origines hellènes, ce Jean-Marc étant né à Cyrène, ancienne ville grecque sur la côte africaine (aujourd’hui en Lybie). Quoi qu’il en soit l’Évangile de Marc est écrite à Rome vers 65, peut être sous la dictée de Pierre lui-même, à une date proche de son martyre, ou peu de temps après sa mort.
Marc écrit un Évangile très court (environ 20 pages de moins que les autres), dans un grec « rugueux » (porté aux sémitismes) et destiné à des non-juifs : en effet il explique les coutumes juives et traduit les mots araméens. Le récit de Marc est concret, parfois brutal (cf. récit de la Passion), plus soucieux des faits établis que des grandes envolées théologiques. La théologie développée dans Marc est très sommaire. Dans sa version originale, Marc n’a pas pratiquement pas d’introduction, ni de conclusion. Sa seule introduction consiste en une ligne : « Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu ». Et le récit original s’achève sur « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici ; voyez l’endroit où on l’avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur (Marc 16, 8) » Quelques récits des apparitions du ressuscité seront ajoutés plus tard.
La problématique centrale de l’Évangile de Marc est l’identité de Jésus : « qui est cet homme ? ». La réponse est donnée au lecteur dans l’introduction et à la fin avec la conversion du centurion romain : « vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » (15,39). Mais tout au long de l’Évangile, le mystère demeure et se dévoile petit à petit. Dans l’Évangile de Marc, Jésus interdit quasi-systématiquement aux malades qu’il guérit et aux démons qu’il expulse de dire qu’il est le Fils de Dieu. Exemple en Marc 11 : Lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Même lorsque Pierre fait un acte de foi en présence des disciples (Marc 8), Jésus « leur défendit vivement de parler de lui à personne ». On parle du « secret messianique » : personne ne peut savoir que Jésus est Dieu avant qu’il ne se soit lui-même révélé par sa mort et sa résurrection, car la royauté de Jésus étant d’essence divine, il ne doit pas être confondu avec un Roi terrestre. Jésus apparaît comme seul et isolé, abandonné de ses disciples et même de sa famille jusqu’à ce que la résurrection leur ouvre les yeux. Marc insiste aussi sur la notion de Royaume de Dieu, son établissement nécessitant une victoire de Jésus sur les démons.
2. Matthieu est un disciple de Jésus (membre des Douze) qu’une tradition du IIème siècle identifie à Lévi, le douanier de Capharnaüm (Mt 9,9). De cette tradition on pensé que l’Évangile de Matthieu aurait été écrite en hébreu voire en araméen, et traduite en grec par un auteur inconnu (une hypothèse l’attribue au diacre Philippe, qui aurait pu prendre le nom d’un apôtre par prestige). Mais l’identification même de Matthieu avec Lévi est contesté par des exégètes (dont Meier), pour qui elle n’apparaît que dans Matthieu, Marc et Luc faisant quant à eux une distinction claire entre Matthieu le membre des Douze et Lévi, appelé par Jésus à le suivre sans être dans la liste des Douze. Ce qui est certain, c’est que l’Évangile est écrite vers 80-90.
L’Évangile de Matthieu est destiné d’abord aux Juifs pour les convaincre que Jésus est le Messie attendu par le peuple d’Israël, comme le montrent plusieurs éléments : l’Évangile commence par une longue généalogie situant le Christ comme héritier direct du roi David (une caractéristique essentielle du Messie attendu par les Juifs), et, pour appuyer sa théorie, Matthieu fait naître Jésus à Bethléem en Judée (au lieu de Nazareth en Galilée) citant immédiatement une parole de l’Ancien Testament : « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël » ; Matthieu n’explique pas les coutumes juives contrairement à Marc ; les références à l’Ancien Testament sont très nombreuses (130 dont 43 explicites !) car il s’agit de mettre l’accent sur le fait que les prophéties de l’Ancien Testament révélaient l’arrivée du Messie. Matthieu compare par exemple Jésus à Moïse : Moïse descendant de la montagne avec les Tables de la Loi, Jésus proclament les Béatitudes sur la Montagne ; Moïse libérant son peuple d’Égypte, Jésus fuyant en Égypte avec sa famille pour échapper à la persécution, etc. Tout son Évangile et son vocabulaire est empreint des traditions liturgiques et ecclésiales juives. Matthieu insiste sur la validité de la loi mosaïque, mais rejette les interprétations des pharisiens au profit de celles de Jésus. L’épisode des « rois » mages veut symboliquement montrer que, comme annoncé dans les Écritures, le Fils de Dieu sera rejeté par les responsables juifs, mais reconnu par les païens.
3. Luc est le médecin et compagnon de Paul (peut être son cousin). Même si, comme les autres évangélistes, on en reste à des hypothèses plus ou moins probables concernant l’identité de l’auteur, celui de l’Évangile de Luc fait davantage consensus parmi les exégètes car il y a une unité de pensée et de langue entre l’Évangile selon Luc et le livre des Actes (également écrit par Luc), d’un côté, et la pensée paulinienne, de l’autre. Quoi qu’il en soit l’Évangile selon Luc est écrite vers 80.
A la suite de Paul, Luc écrit surtout pour les chrétiens issus du paganisme et insiste sur l’universalité du christianisme (le Christ est venu pour tous), ainsi que sur la relation de Jésus avec ses disciples. Notons par exemple que la généalogie de Luc fait remonter le Christ à Adam, père de toute l’humanité, et non pas comme chez Matthieu à Abraham, père du peuple Juif. La question de l’ouverture aux païens et de la transition Juifs-païens (parce que les Juifs ont rejeté la Nouvelle Alliance, ce sont désormais les païens les héritiers de la promesse) est centrale. C’est dans l’Évangile de Luc que l’on trouve le plus de mentions de Jésus visitant des marginaux et des personnages réprouvés par la société juive (exemple : Zachée le collecteur d’impôt) et le plus de Paraboles, notamment celle du Bon samaritain, qui insiste sur le fait que le « prochain » n’est pas forcément le compatriote Juif. Luc va plus loin et lie la fureur de certains Juifs à l’encontre de Jésus à ses discours annonçant que les païens seront mieux traités qu’eux (cf. Luc 4, 27). Au contraire de Marc, Luc, hellénisé comme Paul, écrit dans un excellent grec, plein de subtilité et rigueur, ménageant des pauses voire des petits résumés dans son récit. Il a le souci d’être précis, de restituer les faits et les dates. Son Évangile est subtil, sensible, et insiste davantage que les autres synoptiques sur le pardon accordé à tout pécheur sincèrement repentant, et sur le saint Esprit. Par contre, la connaissance des coutumes juives et de la géographie de la Galilée est beaucoup plus approximative que dans les autres Évangiles. Enfin, même si Jésus reste discret, le principe du secret messianique est évacué : Jésus se manifeste dès le chapitre 4 en affirmant lors d’une lecture à la synagogue qu’une parole d’Isaïe au sujet du Messie le concerne.
4. Jean, enfin, est clairement à part. Il est difficile de démêler ici les noms car de nombreux personnages portent le nom de Jean dans les Évangiles. Un personnage nommé Jean a écrit l’Apocalypse ; un apôtre cité dans les synoptiques (Marc 3, Matthieu 10, Luc 6…) se nomme Jean (le fils de Zébédée). Enfin, on a plusieurs épîtres écrites par un certain Jean. Tous ces Jean sont-ils la même personne ou des personnes différentes ? Nous n’avons pas de certitude à ce sujet. On a longtemps pensé que Jean l’apôtre, Jean l’auteur de l’Évangile, Jean l’auteur des épîtres et Jean l’auteur de l’apocalypse serait la même personne. Quelques arguments que je ne détaillerai pas ici vont dans ce sens, mais les exégètes sont loin d’être unanimes : il y a en effet plusieurs styles à l’intérieur de l’Évangile de Jean et l’évolution de la pensée suggère plusieurs rédacteurs, probablement une communauté johannique qui commence à rassembler des témoignages vers 60. La compilation finale de l’Évangile intervient entre 90 au plus tôt et 125 au plus tard. Remarquons que la forte probabilité d’une écriture par couches successives n’exclut pas l’utilisation d’un témoignage de première main du « disciple que Jésus aimait ».
Quoi qu’il en soit, l’Évangile de Jean est l’Évangile le plus tardif et il propose un projet théologique déjà élaboré. Dans Jean, Jésus n’est pas du tout discret et se déclare Fils de Dieu dès les premiers chapitres : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » (Jn, 1) ou encore : « Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. (…) Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » (Jn, 3). L’Évangile de Jean insiste fortement sur la personne de Jésus lui-même, présenté comme Dieu et Fils de Dieu.
Les synoptiques résonnaient de la « christologie d’en bas » ou « christologie ascendante » : Jésus est présenté comme le Messie, le nouveau Moïse, l’Envoyé de Dieu, qui a une relation unique (ascendante) avec le Père. Cependant il n’est pas explicitement présenté comme Dieu lui-même (cf. infra). Dans Jean, Jésus n’est plus seulement le Messie ou l’Envoyé de Dieu, il est Dieu lui-même, descendu (incarné) sur Terre depuis le « monde d’en haut » (le monde de la Lumière) pour sauver le monde. Tout l’Évangile de Jean est occupé par ce thème théologique central, que les exégètes appelleront « christologie d’en haut » ou « christologie descendante ». Après avoir fidèlement accompli sa mission, Jésus retourne auprès de son Père via la croix, sa glorification définitive, l’acte par lequel il prend sur lui tous les péchés du monde. Autrement dit, et c’est là le point essentiel de l’Évangile de Jean, Jésus n’est pas une créature (ce que niera plus tard l’arianisme). La théologie de Jean est ainsi parfaitement exprimée dans une parole de Jésus à la fin du chapitre 8 : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » Rien d’étonnant, dès lors, à ce que Jésus développe dans cet Évangile de longs discours sur sa relation avec son Père. Le thème du « Royaume de Dieu », omniprésent dans les synoptiques, et clef de lecture centrale de ces derniers, est quasiment absent du quatrième Évangile (seulement deux mentions). Les anecdotes, les personnages, les miracles sont nettement plus rares dans Jean et sont souvent propres à cet Évangile. Les miracles sont organisés selon un schéma théologique bien précis (sept miracles qui culminent avec la résurrection) et toujours présentés comme des signes de la divinité du Christ. Contrairement aux synoptiques les dialogues et surtout les monologues de Jésus à portée métaphorique, les discours de révélation, sont abondants. L’influence de la philosophie grecque est évidente, notamment dans le vocabulaire : Jésus est présenté comme le Logos, le Verbe de Dieu, descendu sur Terre pour une mission précise. Au final, l’Évangile de Jean résonne d’une foi juive méditée à la lumière de la foi en Jésus-Sauveur et Dieu, le tout dans un contexte d’influence d’une pensée grecque teintée de gnosticisme.
Jean est donc le plus symbolique (théologique) des Évangiles, mais, paradoxalement, est aussi l’un des plus historiques : le vocabulaire est très simple, concret, et de nombreux détails prouvent que le ou les auteurs connaissaient fort bien les coutumes religieuses juives de l’époque ; la topographie et la chronologie des évènements sont souvent plus précises que dans les synoptiques, et ont été régulièrement confirmées par l’archéologie (par exemple des détails sur le Temple de Jérusalem, cf. infra). Ainsi, lorsque des détails historiques diffèrent d’avec les synoptiques, les spécialistes ont tendance à faire confiance à Jean.
Conclusion : l’enjeu de la recherche historique
La description qui est faite de Jésus dans ces Évangiles peut apparaître différente voire contradictoire. Au Jésus qui parle peu et interdit qu’on le reconnaisse comme le Fils de Dieu un long moment dans Marc succède un Jésus adepte des longs discours théologiques (cf. le chapitre 17) et s’affirmant Fils de Dieu dans Jean. Des détails, de noms de personnes, de lieu, l’ordre temporel de certains évènements, les mots exacts prononcés par Jésus sont différents, se contredisent parfois. La majorité de ces différences/contradictions concernent des détails : n’oublions pas que les quatre évangiles s’accordent sur les traits essentiels de la vie de Jésus. Mais l’existence même de divergences et surtout de contradictions s’oppose au fondamentalisme biblique qui ne peut les expliquer. Si tout ce qui est raconté dans la Bible s’est réellement produit exactement tel que cela est raconté, alors il ne devrait pas y avoir de contradictions/différences, même mineures.
Cela invite à une lecture plus subtile, distinguant, lorsque c’est possible, l’évènement tel qu’il s’est probablement produit, la parole telle qu’elle remonte probablement au Jésus historique, et les couches successives de sélection des matériaux, d’interprétation, de rédaction ultérieures telles qu’elles ont été réalisées dans l’Église primitive puis mises par écrit par les évangélistes selon leur projet théologique propre et en fonction du développement progressif de la théologique chrétienne à partir du IIème siècle : la doctrine ne s’est pas constituée en un jour !
Cette distinction est bien l’enjeu central de la recherche historique sur Jésus de Nazareth. Elle se veut en ce sens la plus objective possible : John Paul Meier prend l’image d’un « conclave non papal » composé d’un catholique, d’un protestant, d’un juif et d’un agnostique, tous historiens rigoureux, qui devraient se réunir et ne pourraient sortir avant d’avoir élaboré un document consensuel sur Jésus de Nazareth, sorte de « compromis minimal » accepté par tous. Établir en quelque sorte ce document est bien le but de la recherche de Meier. Tout l’enjeu de la recherche historique est donc de faire la part du symbolique et de l’historique, et dans le cas précis des Évangiles, de ce qui remonte ou peut remonter à Jésus lui-même et de ce qui relève plutôt des ajouts ultérieurs dans l’Église primitive.
Comprenons bien que cette distinction est totalement artificielle en ce sens qu’elle est créée par l’historien à partir des textes pour servir son projet propre qui est l’étude de la Bible en dehors de présupposés théologiques. On l’a dit, cette façon de faire a une indéniable utilité, principalement intellectuelle, y compris pour les croyants. Mais cette approche fait aussi violence à des écrits qui n’ont jamais été composés dans un souci de distinction entre foi et fait, symbole et histoire. La mentalité rationaliste moderne qui veut tout expliquer, théoriser, conceptualiser, démontrer scientifiquement est très éloignée de la pensée religieuse du bassin méditerranéen du premier siècle. Répétons donc encore une fois que si la recherche historique avec ses méthodes rigoureuses a de nombreux atouts, y compris pour le croyant, elle ne constitue pas l’objet de la foi. On prend des risques en voulant se servir de la recherche pour justifier ou condamner la foi.
Un certain Juif, Jésus (1/12)
Note de lecture : Négrologie : pourquoi l’Afrique meurt, par Stephen Smith

Je viens de terminer un livre du journaliste américain Stephen Smith intitulé Négrologie : Pourquoi l’Afrique meurt. Paru il y a une dizaine d’année, ce livre a pour (vaste) ambition d’entreprendre une synthèse engagée sur les problèmes économiques, politiques et socioculturels de l’Afrique subsaharienne (l’auteur exclut de son analyse l’Afrique du Nord). De nombreux sujets sont abordés : situation actuelle de l’Afrique, aide au développement, identité africaine et panafricanisme, relations avec l’Occident, etc. Lire la suite