Le statut de la science dans les sociétés contemporaines
Le statut de la science dans les sociétés contemporaines est ambigüe. L’homme du Moyen-âge qui par un étrange voyage dans le temps visiterait notre époque aurait sans doute l’impression, de prime abord, que nous vivons dans une société d’hyper-rationalité scientiste. Les sciences techniques de la nature ont produit en quelques dizaines d’années une quantité phénoménale de technologies qui ont bouleversé le quotidien de millions de personnes : informatique, médecine, aviation, nucléaire, nanotechnologies, etc. C’est l’aspect le plus visible. Par ailleurs les sciences ont aujourd’hui dans l’espace cognitif de la plupart des hommes une place jamais vue, à tel point qu’elles semblent vampiriser tout autre domaine de connaissance. La notion de “conscience” disparaît du champ de la philosophie pour occuper celui des neurosciences ; celle de l’accessibilité du réel est confrontée aux découvertes de la physique quantique. Quant aux sciences sociales, difficile d’avoir (du moins en public) un point de vue sur l’immigration, l’homosexualité, les inégalités, la délinquance, le terrorisme, le chômage ou encore la mondialisation sans tenir compte des leçons de l’économie ou de la sociologie, c’est-à-dire sans multiplier le fact-cheking ou le debunking, pour prendre des termes à la mode : vous passeriez pour un cuistre. Et la morale ? Exit philosophie ou religion, bonjour psychanalyse, sociologie et neurosciences. Aujourd’hui, on explique pourquoi vous pensez ainsi. Demain, la science saura avant vous ce que vous allez penser après-demain.
Est-ce que cet impérialisme scientifique a fait des sociétés contemporaines des sociétés scientifiques ? Pas vraiment. C’est là un paradoxe de la démocratie : si son développement a permis l’émancipation des sciences de la tutelle politico-religieuse inscrivant tel ou tel sujet à l’index, il a concomitamment favorisé la critique de la science. Ce phénomène s’est beaucoup accentué depuis l’avènement des réseaux sociaux. Et c’est ainsi que nous vivons à une époque de scepticisme aigüe à l’égard des sciences, une époque que le sociologue Gérald Bronner appelle “la démocratie des crédules”. Qu’on en juge : les horoscopes se vendent toujours aussi bien ; les théories du complot pullulent ; des méfiances irrationnelles, soit qu’elles vont bien au-delà d’une prudence raisonnable, soit qu’elles ne sont fondées sur aucun argument sérieux, se multiplient (à propos des OGM, des vaccins, des ondes, du réchauffement climatique …) ; quant aux réseaux sociaux, ils sont le lieu de toutes les rumeurs infondées, de toutes les joutes de sophistes : attaques ad hominem, généralisations hâtives, images trafiquées, informations non vérifiées, surréactions émotionnelles, renversement de la charge de la preuve, arguments d’autorité, biais de confirmation, faux dilemme, etc. Et les scientifiques ? quand ils ne sont pas considérés comme inféodés aux intérêts économiques (les physiciens au nucléaire, les biologistes à l’industrie alimentaire, les économistes aux banques…), ils sont raillés pour leur dogmatisme ou leurs contradictions internes. Ce scepticisme est-il lié à un manque d’éducation ? Jamais les populations des grands pays développés n’ont été aussi éduquées, l’allongement des études ayant crû continument depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Au poids des religions ? Le nombre de personnes déclarant que la religion joue un rôle très important dans leur vie est en France inférieur à 15%, l’un des taux les plus bas du monde (lien). A internet ? S’il facilite la diffusion des rumeurs, il permet aussi un accès à la connaissance qui semblerait totalement inouï au plus érudit des conservateurs de l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie, la plus grande du monde antique…
Passant davantage de temps chez nous, notre visiteur du Moyen-âge se rendrait compte que nous sommes loin d’être aussi rationnels que nos technologies le laissent supposer, et peut être pas beaucoup plus que lui.
***
C’’est cette ambigüité que je voudrais aujourd’hui mieux comprendre. D’un côté, la science va toujours plus loin et nous lui confions chaque jour nos vies, quand nous montons dans un avion, utilisons un GPS ou acceptons une opération sous anesthésie générale. De l’autre, jamais la contestation de la science n’a été aussi facile, et aussi répandue. Ce conflit, qui peut nous traverser tous (nous acceptons la science quand elle est nous est utile, et la contestons quand elle remet en cause nos préjugés), est aussi celui de deux camps opposés, que je considère aussi faux l’un que l’autre. Commençons donc par les nommer.
Deux conceptions erronées de la Raison
1. Le relativisme radical
Qui sont les relativistes ? des individus qui ont étudiés à fond la philosophie de la connaissance, sur laquelle ils fondent un doute radical à l’égard de l’objectivité des sciences. Les principaux arguments sont connus depuis longtemps : premièrement, les connaissances ne volent pas dans les airs, elles s’incarnent nécessairement dans des êtres humains qui ne peuvent pas être objectifs, puisqu’ils sont limités par leur entendement (la façon de percevoir et d’ordonner la réalité qui s’offre à nous). Nos sens sont limités et les illusions d’optique (pour ne prendre que cet exemple) montrent que notre cerveau se trompe fréquemment. Si “objectivité” veut dire connaissance indépendante du sujet connaissant, il n’y a jamais d’objectivité, ni en sciences, ni ailleurs, puisqu’il n’existe pas de sujet omniscient, aucun “point de vue de nulle part” qui nous donnerait accès à la réalité pure et totale, à ce monde des Idées Objectives auxquels certains philosophes de l’Antiquité croyaient pouvoir accéder et que Kant a appelé les noumènes. Un peu comme si, voyant une table, j’étais capable d’un seul coup d’œil de saisir non seulement sa forme et sa couleur, mais encore ses atomes, le mouvement des électrons autour du noyau, la composition chimique de son bois, sa structure métallique interne, la façon dont la lumière émise par le soleil se réfléchit sur la table et revient dans mon œil, ou même son histoire depuis l’abattage de l’arbre jusqu’à l’assemblage des éléments, voire ce que signifie intrinsèquement le concept de table et ce que signifie le concept de « moi » pensant à une table…et ce, instantanément ! C’est évidemment impossible : nous n’avons accès qu’aux phénomènes, pas aux noumènes ; seulement aux choses telles qu’elles s’offrent à nous (et dans la limite de notre entendement), pas aux choses en soi. La connaissance objective est la connaissance débarrassée du sujet et, dès lors, le seul être humain objectif est… mort.
D’autre part, au plan dialectique, la connaissance n’interviendrait qu’après l’expérience d’un phénomène. Selon Michel Onfray (lien), “la raison est un instrument sophistique qu’on fait fonctionner après avoir eu des émotions, des sensations, des expériences”. C’était exactement le point de vue de David Hume : toute connaissance est une accumulation d’expériences sensibles, de sensations, de passions et d’émotions. De là nous fondons des idées, associations de connaissances à base de mémoire et d’imagination. Autant dire que rien n’est objectif dans tout cela : pour Hume, la connaissance est équivalente à la croyance. Elle peut avoir une utilité pour l’action, mais ne dit rien du réel. La vérité nous échappe en tout.
Pour parachever d’achever la science, la sociologie nous affirme depuis quelques dizaines d’années que nous sommes tellement influencés par les groupes sociaux auxquels nous appartenons, et les normes qu’ils répandent, que tout ce que nous croyons être “vérité”, “justice”, “droit”, “valeurs”, “traditions” ou “science” n’est guère que construction sociale. Nous percevons comme inhérentes ou naturelles des institutions ou des croyances qui ne sont que des accumulations d’assimilations vaguement conscientes typifiées par des décennies de contrôle social (je fais exprès d’imiter la prose absconse de ce genre de discours). Nos certitudes ne sont que des croyances auxquelles nous adhérons parce qu’elles conviennent à notre époque, pour toutes sortes de raisons. Quant à nos “faits scientifiques” soit-disant “prouvés”, les sociologues des sciences comme Bruno Latour montrent qu’ils ne sont que des observations socialement construites et subjectivement interprétées à partir d’instruments de mesure eux-mêmes socialement construits. “La” science a ses querelles d’égos, ses traditions informelles, ses réseaux de pouvoir, ses pratiques culturelles spécifiques et mêmes ses modes (un jour les neurosciences, le lendemain les expérimentations psychologiques, dans un camp l’expérimentation, dans l’autre la théorisation, un jour le BigData, un autre la microanalyse)… sans parler de ses tricheries ! Au fond, disent les relativistes, la science n’est rien d’autre qu’un système de croyance plus élaboré… et plus légitime. Il y a deux ans, j’avais écrit :
L’excellent journaliste scientifique Pierre Barthélémy a rappelé à de multiples reprises que les chercheurs passent plus de temps à essayer de faire la découverte extraordinaire ou publier LE papier original qu’à vérifier la rigueur scientifique de leurs analyses. Régulièrement, on apprend qu’une étude a montré ci ou ça. Mais combien contiennent des biais statistiques et méthodologiques ? Combien de jeux de données “oubliés” ou interprétés d’une façon qui va dans le sens de la conclusion attendue ? Combien de fois parvenons-nous à reproduire les résultats de l’étude en question ? Combien de chercheurs vérifient les travaux de leurs collègues ? Combien de biais liés à la politique, les préjugés, les intérêts financiers ? Et si c’est déjà le cas dans les milieux scientifiques, hyper-spécialisés, hyper-formés, hyper-intelligents, que peut-on dire des autres milieux ?
La conclusion des relativistes ? La vérité n’existe pas : elle n’est qu’un produit du consensus, du plus large “accord intersubjectif possible”, pour reprendre les termes d’un philosophe américain (lien). La science n’existe pas : elle n’est qu’un affrontement subjectif d’opinions plus ou moins fondées. Etre vrai et être tenu pour vrai sont une seule et même chose. Et puis, croire qu’on détient “la vérité”, n’est-ce pas affreusement dogmatique, pour ne pas dire totalitaire ? Se débarrasser du concept de vérité, c’est faire d’une pierre deux coups : au plan épistémique, on se débarrasse d’une illusion ; au plan politique, on supprime une tentation autoritaire.
2. Le scientisme
Qui sont les scientistes ? des individus avec un intérêt affirmé pour la science, et qui veulent lui voir occuper tous les domaines de la vie. A l’opposé exact des relativistes, ils ont dans la science une confiance radicale. Du point de vue théorique, le scientisme est fils du matérialisme : on part d’abord du postulat philosophique que tout ce qui n’est pas matière n’existe pas, et conséquemment que tout ce que la science n’a pas positivement mis en évidence n’existe pas (puisque la science étudie la matière et seulement la matière). Prenons l’être humain. Du point de vue matérialiste nous ne sommes qu’entrelacs de neurones, de veines, de synapses, de flux d’informations traduits en impulsions électriques. L’esprit n’est que chimie : dès lors, la musique n’est qu’une vibration dans l’air affectant votre tympan, les émotions sont les seuls fruits de l’action de vos récepteurs opiacés, la dépression la conséquence d’un déficit en sérotonine, une belle femme n’est qu’un flux de lumière dans votre œil, et les plus hautes vertus morales des connexions neuronales.
Adieu les « Je t’aime ». Il est maintenant plus rationnel de dire : « le néocortex qui fabrique mon moi est excité jusqu’en sa zone de Broca par les stimuli nerveux causés par cet agrégat d’atomes anthropoïde que par commodité on appelle « toi »
Fabrice Hadjadj
Ainsi, le scientiste considère qu’on ne peut connaître le monde que par la science : tout ce qui n’est pas scientifiquement connaissable n’est pas connaissable du tout. A la rigueur, tout ce qui n’est pas scientifique est considéré comme superstitieux (et au premier chef la religion) : c’est ou science, ou superstition. Conséquence politique possible : tous les problèmes qui concernent l’humanité devraient être réglées par la science et uniquement par la science. La science devrait régenter tous les domaines de la vie : morale (fruit de délibérations rationnelles), politique (dont les projets devraient être fondées sur la science), arts, culture, etc.
Il va de soi que les scientistes sont athées. Ceci étant dit, il existe une catégorie d’individus que je classerai volontiers parmi les scientistes, bien qu’ils soient rarement athées. Il s’agit d’individus ayant de fortes croyances religieuses ou philosophiques, et qui cherchent à utiliser la science pour justifier ces croyances. Ici, on utilise des résultats de la science (souvent mal assimilés) pour justifier des croyances politiques, philosophiques et surtout religieuses. Ainsi, on cherche à utiliser la cosmologie comme une preuve de l’existence de Dieu, des résultats historiques comme preuve de la vérité du Coran ou de la divinité de Jésus de Nazareth, ou des expériences médicales (comme les NDE, Near Death Experience) comme preuve de la vie après la mort. Le problème est ici celle du mélange des genres entre science et religion, raison et foi. Le dialogue entre foi et raison est nécessaire, tant au point de vue institutionnel qu’individuel, mais un dialogue suppose une distinction claire, ce que ne font pas ceux qui veulent utiliser la physique pour faire de la métaphysique. C’est pour cela que je les appelle scientistes : comme leurs ennemis les athées, ils utiliser la science au lieu de la servir, quitte à en faire une religion.
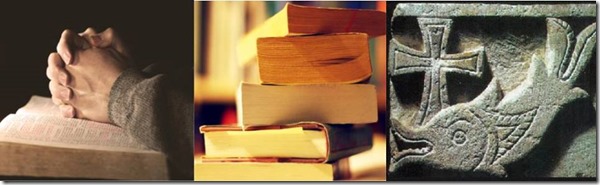
Pingback: Science, mythe et religion : des usages de la Raison (3/3) – Des hauts et débats
Pingback: Un certain Juif, Jésus (7/9) – Des hauts et débats